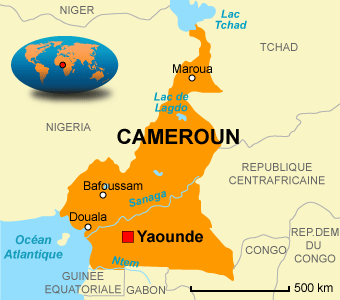
Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale qui a une superficie de 475.000 km² et une population estimée à 20 millions d’habitants. Il dispose d’une façade maritime qui fait partie du secteur central du golfe de Guinée et qui s’étend sur environ 360 km entre le Nigeria et la Guinée Equatoriale (FAO 2003, Country Profile). La pêche est très active dans le pays et représente un secteur important tant du point de vue socio-économique qu’alimentaire. Elle est organisée autour de quatre branches : la pêche industrielle, la pêche artisanale maritime, la pêche continentale et l’aquaculture. La pêche artisanale maritime et la pêche continentale qui sont exclusivement du ressort des populations rurales emploient plus de 200.000 personnes dont 65.000 en emplois directs (pêcheurs) et 135.000 en emplois indirects (transformateurs, commerçants, fabricants et réparateurs d’embarcations et d’engins, etc.), et débarquent annuellement plus de 140.000 tonnes de produits dont 90.000 tonnes pour la pêche artisanale maritime et 50.000 tonnes pour la pêche continentale(Enquete cadre MINEPIA, 2009). La pêche industrielle produit un peu moins de 8.000 tonnes par an et l’aquaculture un plus de 2.000 tonnes. Les exportations qui portent essentiellement sur les crevettes pêchées par la pêche industrielle sont négligeables, ce qui donne une production nationale estimée à 150.000 tonnes par an, et un disponible de 127.500 tonnes après déduction des 15% de pertes après captures (Njifonjou & Henry, 2009). Les besoins annuels de la population se situent autour de 247.500 tonnes pour une consommation moyenne par tête de 15,5 kg. Pour résorber le déficit, le pays importe chaque année près de 120.000 tonnes de poissons (Boukari, 2010). Ces importations qui proviennent essentiellement du Sénégal et de la Mauritanie portent pour plus de 90% sur les chinchards, les maquereaux et les sardines, espèces bon marché particulièrement appréciées par les couches les plus démunies de la population.
Les espèces démersales sont reconnues être en état de surexploitation. Cet état de surexploitation qui remonte à l’année 1986 a été documenté par plusieurs auteurs dont Njock (1990, 2000, 2001); Djama, (1988, 1992, 2004) et Djama & Pitcher (1997, 1989). Selon ces auteurs, la PUE estimée à environ 18 000 tonnes de poissons par an pour un effort d'environ 2300 jours de pêche et le taux d'exploitation (le ratio de la mortalité par la pêche au total pour les huit espèces démersales communes, Pseudotolithus spp., Cynoglossus spp., Galoides decadactylus, quinquarius, Pentanemus et Arius spp) sont supérieures à 0,5 ce qui signifie que ces espèces sont déjà menacées d'une surexploitation. Cette constatation a été confirmée récemment pour Pseudotolithus spp., en utilisant le modèle de production de Schaefer par le groupe de travail FAO/COPACE sur les ressources démersales en Sierra Leone en 2008, ainsi que par les campagnes océanographiques du navire de recherche Fritdjof Nansen (Krakstad et al, 2004,2005, 2006) avec des faibles taux de capture enregistrés sur les espèces démersales d’importance commerciale. Dans ce groupe des démersaux se trouvent aussi les espèces telles Ariomma bondi, en grande quantité, mais qui ne sont pas encore exploitées du fait des profondeurs de pêche qui nécessitent des bateaux à grand tirant d’eau. Ce groupe est bien distribué le long de la frontière maritime du Nigéria en Guinée Equatoriale et est bien exploité au Nigéria sous-forme de conserve.
Peu d’études ont été faites sur les crevettes des eaux camerounaises. Néanmoins l’évolution des captures des crevettiers ont chuté régulièrement de 1978 jusqu'à 2010. Cette chute est accompagnée d’une augmentation de l’effort de pêche en nombre des crevettiers. A titre d’illustration, en 2006, 51 navires de pêche ont débarqué 3,502 tonnes de produit, représentant une diminution de plus de 10% sur les 3,919 tonnes débarqués par 9 chalutiers en 1970. Cette tendance à la baisse est principalement liée à une détérioration de la ressource crevettière et à la naissance de réseaux d’exportations clandestines.
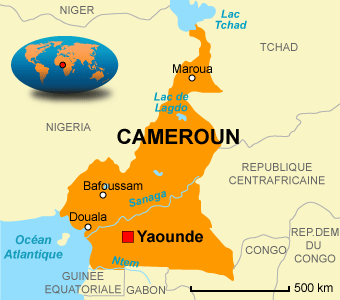 Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale qui a une superficie de 475.000 km² et une population estimée à 20 millions d’habitants. Il dispose d’une façade maritime qui fait partie du secteur central du golfe de Guinée et qui s’étend sur environ 360 km entre le Nigeria et la Guinée Equatoriale (FAO 2003, Country Profile). La pêche est très active dans le pays et représente un secteur important tant du point de vue socio-économique qu’alimentaire. Elle est organisée autour de quatre branches : la pêche industrielle, la pêche artisanale maritime, la pêche continentale et l’aquaculture. La pêche artisanale maritime et la pêche continentale qui sont exclusivement du ressort des populations rurales emploient plus de 200.000 personnes dont 65.000 en emplois directs (pêcheurs) et 135.000 en emplois indirects (transformateurs, commerçants, fabricants et réparateurs d’embarcations et d’engins, etc.), et débarquent annuellement plus de 140.000 tonnes de produits dont 90.000 tonnes pour la pêche artisanale maritime et 50.000 tonnes pour la pêche continentale(Enquete cadre MINEPIA, 2009). La pêche industrielle produit un peu moins de 8.000 tonnes par an et l’aquaculture un plus de 2.000 tonnes. Les exportations qui portent essentiellement sur les crevettes pêchées par la pêche industrielle sont négligeables, ce qui donne une production nationale estimée à 150.000 tonnes par an, et un disponible de 127.500 tonnes après déduction des 15% de pertes après captures (Njifonjou & Henry, 2009). Les besoins annuels de la population se situent autour de 247.500 tonnes pour une consommation moyenne par tête de 15,5 kg. Pour résorber le déficit, le pays importe chaque année près de 120.000 tonnes de poissons (Boukari, 2010). Ces importations qui proviennent essentiellement du Sénégal et de la Mauritanie portent pour plus de 90% sur les chinchards, les maquereaux et les sardines, espèces bon marché particulièrement appréciées par les couches les plus démunies de la population.
Les espèces démersales sont reconnues être en état de surexploitation. Cet état de surexploitation qui remonte à l’année 1986 a été documenté par plusieurs auteurs dont Njock (1990, 2000, 2001); Djama, (1988, 1992, 2004) et Djama & Pitcher (1997, 1989). Selon ces auteurs, la PUE estimée à environ 18 000 tonnes de poissons par an pour un effort d'environ 2300 jours de pêche et le taux d'exploitation (le ratio de la mortalité par la pêche au total pour les huit espèces démersales communes, Pseudotolithus spp., Cynoglossus spp., Galoides decadactylus, quinquarius, Pentanemus et Arius spp) sont supérieures à 0,5 ce qui signifie que ces espèces sont déjà menacées d'une surexploitation. Cette constatation a été confirmée récemment pour Pseudotolithus spp., en utilisant le modèle de production de Schaefer par le groupe de travail FAO/COPACE sur les ressources démersales en Sierra Leone en 2008, ainsi que par les campagnes océanographiques du navire de recherche Fritdjof Nansen (Krakstad et al, 2004,2005, 2006) avec des faibles taux de capture enregistrés sur les espèces démersales d’importance commerciale. Dans ce groupe des démersaux se trouvent aussi les espèces telles Ariomma bondi, en grande quantité, mais qui ne sont pas encore exploitées du fait des profondeurs de pêche qui nécessitent des bateaux à grand tirant d’eau. Ce groupe est bien distribué le long de la frontière maritime du Nigéria en Guinée Equatoriale et est bien exploité au Nigéria sous-forme de conserve.
Peu d’études ont été faites sur les crevettes des eaux camerounaises. Néanmoins l’évolution des captures des crevettiers ont chuté régulièrement de 1978 jusqu'à 2010. Cette chute est accompagnée d’une augmentation de l’effort de pêche en nombre des crevettiers. A titre d’illustration, en 2006, 51 navires de pêche ont débarqué 3,502 tonnes de produit, représentant une diminution de plus de 10% sur les 3,919 tonnes débarqués par 9 chalutiers en 1970. Cette tendance à la baisse est principalement liée à une détérioration de la ressource crevettière et à la naissance de réseaux d’exportations clandestines.
Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale qui a une superficie de 475.000 km² et une population estimée à 20 millions d’habitants. Il dispose d’une façade maritime qui fait partie du secteur central du golfe de Guinée et qui s’étend sur environ 360 km entre le Nigeria et la Guinée Equatoriale (FAO 2003, Country Profile). La pêche est très active dans le pays et représente un secteur important tant du point de vue socio-économique qu’alimentaire. Elle est organisée autour de quatre branches : la pêche industrielle, la pêche artisanale maritime, la pêche continentale et l’aquaculture. La pêche artisanale maritime et la pêche continentale qui sont exclusivement du ressort des populations rurales emploient plus de 200.000 personnes dont 65.000 en emplois directs (pêcheurs) et 135.000 en emplois indirects (transformateurs, commerçants, fabricants et réparateurs d’embarcations et d’engins, etc.), et débarquent annuellement plus de 140.000 tonnes de produits dont 90.000 tonnes pour la pêche artisanale maritime et 50.000 tonnes pour la pêche continentale(Enquete cadre MINEPIA, 2009). La pêche industrielle produit un peu moins de 8.000 tonnes par an et l’aquaculture un plus de 2.000 tonnes. Les exportations qui portent essentiellement sur les crevettes pêchées par la pêche industrielle sont négligeables, ce qui donne une production nationale estimée à 150.000 tonnes par an, et un disponible de 127.500 tonnes après déduction des 15% de pertes après captures (Njifonjou & Henry, 2009). Les besoins annuels de la population se situent autour de 247.500 tonnes pour une consommation moyenne par tête de 15,5 kg. Pour résorber le déficit, le pays importe chaque année près de 120.000 tonnes de poissons (Boukari, 2010). Ces importations qui proviennent essentiellement du Sénégal et de la Mauritanie portent pour plus de 90% sur les chinchards, les maquereaux et les sardines, espèces bon marché particulièrement appréciées par les couches les plus démunies de la population.
Les espèces démersales sont reconnues être en état de surexploitation. Cet état de surexploitation qui remonte à l’année 1986 a été documenté par plusieurs auteurs dont Njock (1990, 2000, 2001); Djama, (1988, 1992, 2004) et Djama & Pitcher (1997, 1989). Selon ces auteurs, la PUE estimée à environ 18 000 tonnes de poissons par an pour un effort d'environ 2300 jours de pêche et le taux d'exploitation (le ratio de la mortalité par la pêche au total pour les huit espèces démersales communes, Pseudotolithus spp., Cynoglossus spp., Galoides decadactylus, quinquarius, Pentanemus et Arius spp) sont supérieures à 0,5 ce qui signifie que ces espèces sont déjà menacées d'une surexploitation. Cette constatation a été confirmée récemment pour Pseudotolithus spp., en utilisant le modèle de production de Schaefer par le groupe de travail FAO/COPACE sur les ressources démersales en Sierra Leone en 2008, ainsi que par les campagnes océanographiques du navire de recherche Fritdjof Nansen (Krakstad et al, 2004,2005, 2006) avec des faibles taux de capture enregistrés sur les espèces démersales d’importance commerciale. Dans ce groupe des démersaux se trouvent aussi les espèces telles Ariomma bondi, en grande quantité, mais qui ne sont pas encore exploitées du fait des profondeurs de pêche qui nécessitent des bateaux à grand tirant d’eau. Ce groupe est bien distribué le long de la frontière maritime du Nigéria en Guinée Equatoriale et est bien exploité au Nigéria sous-forme de conserve.
Peu d’études ont été faites sur les crevettes des eaux camerounaises. Néanmoins l’évolution des captures des crevettiers ont chuté régulièrement de 1978 jusqu'à 2010. Cette chute est accompagnée d’une augmentation de l’effort de pêche en nombre des crevettiers. A titre d’illustration, en 2006, 51 navires de pêche ont débarqué 3,502 tonnes de produit, représentant une diminution de plus de 10% sur les 3,919 tonnes débarqués par 9 chalutiers en 1970. Cette tendance à la baisse est principalement liée à une détérioration de la ressource crevettière et à la naissance de réseaux d’exportations clandestines.  COREP Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée
COREP Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée